Les sages-femmes et le deuil périnatal
Parce que les soignant·es en général et les sages-femmes en particulier ont un rôle clé dans le vécu du deuil périnatal.
Au Revoir Podcast est une aventure permise grâce au soutien des auditeur·ices. Le podcast vous a permis de vous sentir moins seul·es ? Vous a donné des clés en tant que proche ou professionnel·les ? Vous pouvez faire un petit don mensuel ou ponctuel pour m’aider à faire mon travail dans de bonnes conditions ! Merci à vous !
Bonjour à tou·tes,
Pour cette nouvelle lettre d’information d’Au Revoir Podcast, j’avais très envie de revenir sur l’un des derniers épisodes que j’ai mis en ligne après une longue pause : “Les sages-femmes face au deuil périnatal”, réalisé en partenariat avec l’association Petite Émilie.
Association sans appartenance politique ou religieuse, Petite Émilie rassemble des parents et des soignant·es. Elle œuvre pour un meilleur accompagnement des personnes confrontées à une interruption médicale de grossesse et à un deuil périnatal. Un grand merci à Petite Émilie d'avoir choisi Au Revoir Podcast pour mettre en lumière ses actions et et vous faire découvrir d'autres récits et témoignages à propos du deuil périnatal !
Retrouvez tous les épisodes en partenariat avec Petite Émilie.
En septembre 2024, j’ai pris mon enregistreur et mes micros et je me suis rendue à l’école de sages-femmes de Caen, en Normandie, pour un reportage : ce jour-là, les étudiant·es de 4e année accueillaient Amanda et Marie-Hélène, toutes deux bénévoles de Petite Émilie pour une après-midi de formation à propos du deuil périnatal.
Dans cet épisode mis en ligne sur Au Revoir Podcast, l’idée n’était pas de retranscrire le contenu de la formation mais d’être au plus près de ces futur·es soignant·es : les laisser exprimer leurs attentes, leurs questionnements, capturer leurs échanges avec Amanda et Marie-Hélène.

Au micro d’Au Revoir Podcast, quatre étudiantes - Marine, Blanche, Célia et Lilia - sont notamment revenues sur leur vision du métier, ont expliqué comment elles avaient été confrontées au deuil périnatal jusqu’à présent, ont souligné ce qu’elles ont retenu de ce temps d’échange avec les bénévoles de l’association. Toutes n’avaient pas forcément pris la mesure de ce qu’était cette épreuve avant de commencer leurs études. Pourtant, j’ai été frappée par leur maturité, leur capacité à cerner très rapidement ce qui pouvait faire la différence dans un accompagnement :
“Avant d'entrer en école, je pense que j'avais un côté plutôt naïf (…). Lors de mon premier stage en salle de naissance, où sur le même jour on a eu deux morts foetales in utero à terme, c'était assez violent. Il y avait tout le côté médical à prendre en charge, réussir à trouver les bons mots, essayer de se mettre à la place de cette maman.”
“Dans la gestion de la douleur, le fait que les femmes soient accompagnées tout le long, ça peut totalement changer un [accouchement]. Je me dis que là, c'est une douleur qui est psychologique. Et c'est pareil : l'accompagnement est la clé de beaucoup de choses pour après.”
Tout·es ont conscience de ce qui peut faire la différence : les mots, l’importance de reconnaître le vécu des femmes, des couples, d’humaniser aussi ce bébé qui était attendu…
À ce propos, tou·tes les patient·es ne ressentent pas ce besoin d’“humaniser” le foetus : même quand la grossesse est avancée, que le bébé avait déjà un prénom, qu’on le sentait bouger, le choc de l’annonce peut amener à ériger des barrières pour se protéger. C’est ce qu’a notamment constaté l’une des étudiantes. Lors d’un stage, elle a accompagné un couple qui vivait une IMG au cours du 2e trimestre de grossesse.
Ça m'avait marquée parce que ce n'était pas du tout “humanisé” comme moment. Ce n’était pas un bébé, ce n’était pas un fœtus, c’était... C’était juste un “embryon”, un “amas de cellules” selon les mots de la patiente qui ne se sentait pas du tout maman.
Tandis que la femme ne voulait plus parler de son bébé et que le couple avait caché cette épreuve à son entourage, l’équipe avait décidé malgré tout de constituer une boîte avec des empreintes, des photos, un bracelet de naissance etc. Le but ? Permettre aux parents, une fois le moment de la sidération passé, d’avoir accès à ces souvenirs s’ils en ressentaient le besoin.
Ce cas de figure montre l’importance, pour les soignant·es et tout particulièrement les sages-femmes qui sont au plus près des patient·es de s’adapter complètement à ces dernier·es :
C'est une histoire à chaque fois différente. Comment appelle-t-on l'enfant ? Nous, ce qu'on préconise pour les soignant·es, c'est d'attendre de voir comment les parents en parlent. Parce que du coup, il y a des parents qui peuvent être dans une position de protection. Il y a deux minutes, ils parlaient de leur futur bébé (…) tt maintenant, ils vont dire “le "fœtus”. Il faut juste que les soignant·es apprennent à danser avec les parents.
Amanda et Marie-Hélène, bénévoles chez Petite Émilie.
Alors un grand merci aux soignant·es qui ont appris à danser avec les parents.
Merci à celle·ux qui ont su trouver les bons mots, qui ont su se hisser à la hauteur de l’enjeu.
Merci à ces personnes qui ont su injecter un peu de douceur et d’humanité dans cette épreuve.
Et pour les remercier encore plus, j’ai décidé de remettre à l’honneur un épisode initialement mis en ligne le 8 mars 2022. Intitulé “Sages-femmes : à celles qui nous ont tant aidé·es dans notre deuil périnatal”, il regroupe de court témoignages de femmes qui ont croisé la route d’un·e formidable sage-femme.
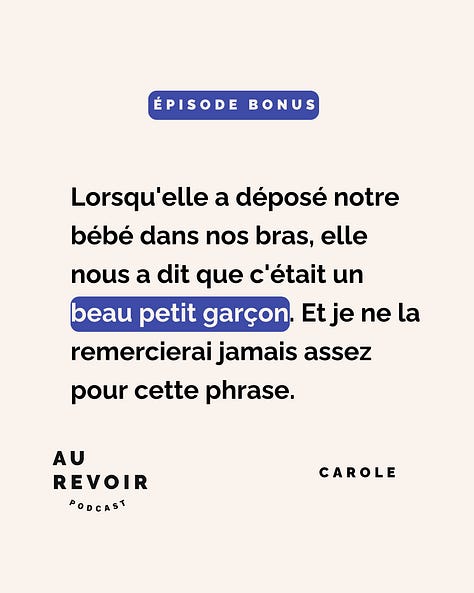


Vous avez déjà écouté les épisodes d’Au Revoir Podcast et les avez appréciés ? N’hésitez pas à mettre un petit commentaire et des étoiles sur les plateformes d’écoute pour donner plus de visibilité au podcast et au deuil périnatal !
Merci à vous d’avoir pris le temps de lire cette édition des nouvelles d’Au Revoir Podcast !
Je vous dis à très vite et, d’ici là, n’hésitez pas à partager cette lettre et les épisodes autour de vous : c’est essentiel pour donner plus de visibilité au deuil périnatal, au podcast et à mon travail !
Amicalement,
Sophie





